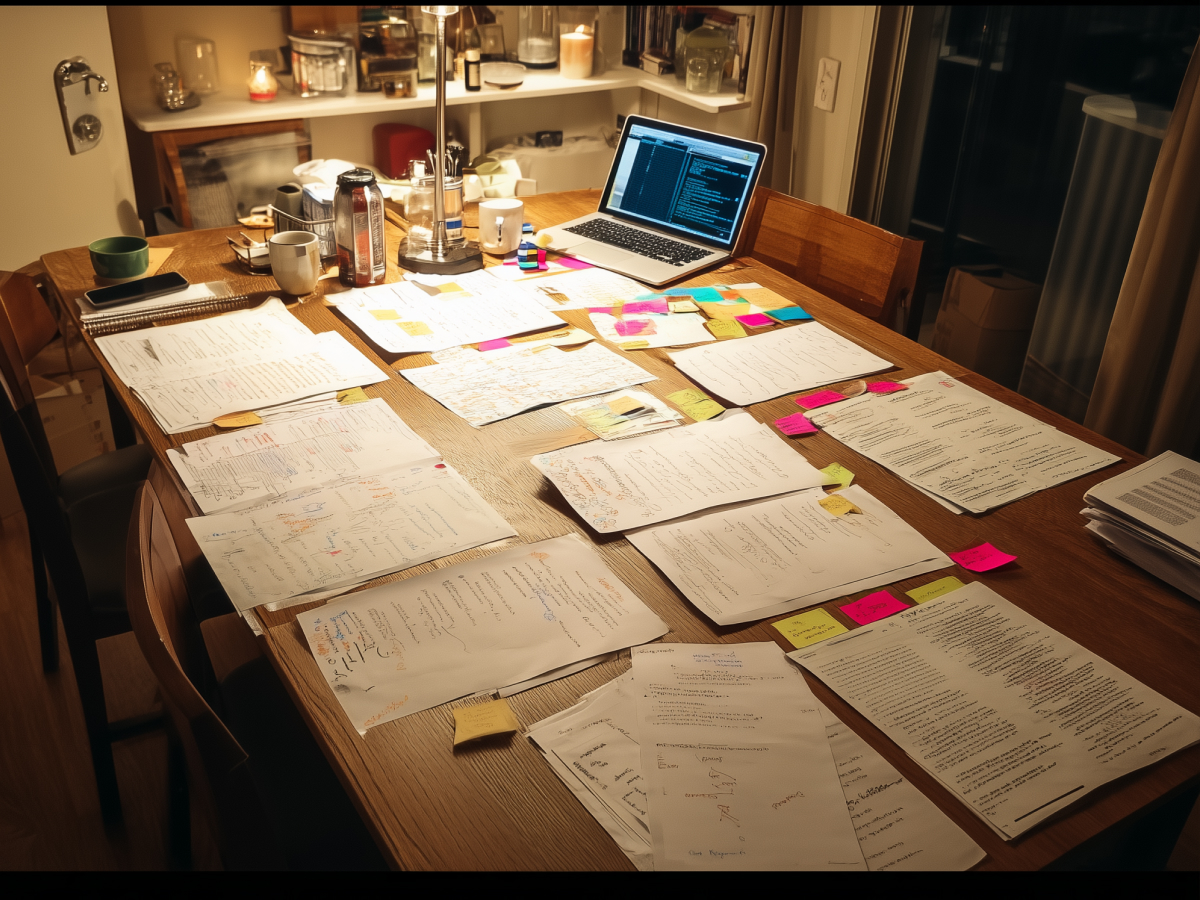Le cloud n’est pas cassé, mais si vous commencez à douter de son commencez à vous interroger sur son retour sur investissementvous n’êtes pas seul. Un nombre croissant d’entreprises retirent certaines charges de travail de l’infrastructure publique, AWS, Azure, Google Cloud, et les ramènent en interne. Pourquoi ? Parce que la facture est arrivée à échéance et qu’elle est élevée.
Le cloud a été commercialisé comme l’alternative la plus simple et la plus rentable au matériel physique. C’était vrai il y a dix ans. Les entreprises voulaient de la vitesse, de l’échelle et de la résilience sans avoir à acheter des serveurs ou à gérer une infrastructure physique. Mais la croissance a changé la donne. Ce qui fonctionnait pour une équipe technique de 50 personnes ne s’adapte pas à une entreprise de 5 000 personnes sans compromis. C’est ce que nous constatons aujourd’hui.
Le rapatriement des charges de travail n’a pas pour but d’abandonner le cloud, mais de repenser les domaines dans lesquels le cloud vous est encore utile et ceux dans lesquels il ne l’est manifestement plus. Vous ne revenez pas en arrière. Vous allez de l’avant avec de meilleures données, des objectifs plus clairs et plus de contrôle. Et c’est bien là l’objectif : contrôler vos performances, vos coûts et votre future architecture.
Lorsque vous réévaluez vos décisions en matière d’infrastructure, vous ne réagissez pas sous le coup de l’émotion. Vous optimisez la clarté, les coûts et les capacités. C’est ainsi que la technologie devrait fonctionner.
Les dirigeants confondent souvent le rapatriement du cloud avec un échec de la stratégie. Ce n’est pas le cas. C’est le signe que votre organisation a évolué. Vous n’êtes plus en train de faire évoluer une startup, vous gérez une complexité opérationnelle. S’affranchir des hypothèses de coûts intégrées est stratégique et non réactionnaire. Le rapatriement signifie simplement que vous recalibrez le système pour servir vos objectifs à long terme.
Les coûts surprises et les coûts cachés du cloud sont les principaux moteurs de la tendance au rapatriement
La plupart des équipes financières ne se voient pas imposer une facture massive de cloud à cause d’une seule erreur majeure. Elles sont touchées par une centaine de petites erreurs. Et elles s’accumulent rapidement.
La facturation du cloud n’est pas aussi transparente qu’elle devrait l’être. Les valeurs par défaut sont coûteuses. Les machines mal configurées fonctionnent au ralenti. Les règles de mise à l’échelle automatique créent plus d’instances que nécessaire. Vos développeurs lancent des environnements de test et les oublient. Vous payez pour chaque octet traversant une région ou quittant le cloud, sans toujours savoir ce qui a déclenché les frais. Ce bruit se transforme en argent réel.
Tout le monde commence par utiliser le cloud en toute bonne foi. Puis la facture mensuelle apparaît… et personne ne peut l’expliquer en moins d’une heure. C’est un problème. Si vous ne pouvez pas faire remonter les coûts à des décisions d’infrastructure spécifiques, vous n’utilisez pas un système évolutif, vous êtes en pilotage automatique. Et le pilotage automatique ne devrait pas coûter 3 millions de dollars par an.
C’est ce qui s’est passé chez 37Signals. Malgré l’optimisation de leur utilisation d’AWS, leur directeur technique, David Heinemeier Hansson, a déclaré qu’ils avaient encore dépensé 3,2 millions de dollars en 2022. Près de la moitié de cette somme a été consacrée au stockage. Ce type de dépenses les a conduits à commencer à déplacer leurs plateformes Basecamp et HEY hors du cloud. Pas du jour au lendemain. De manière stratégique. Ils construisent pour l’indépendance.
En tant que dirigeant, vous devez attendre de la clarté et du contrôle, et non de la surprise. Les budgets ont besoin de prévisions. Le rapatriement ne consiste pas à fuir le cloud, mais à éliminer l’imprévisibilité. Si votre équipe ne sait pas d’où vient la moitié de vos coûts de cloud, vous n’optimisez pas, vous absorbez les pertes. Et ce n’est pas durable. Orientez-vous résolument vers des systèmes que vous pouvez auditer, déboguer et budgétiser de manière cohérente.
La prolifération des clouds aggrave considérablement les dépenses incontrôlées dans ce domaine.
La simplicité du déploiement des services cloud fait partie du problème. N’importe quelle équipe, dans n’importe quel service, peut mettre en place des instances, des bases de données, des API et des charges de travail en quelques minutes. Mais la facilité s’accompagne du chaos, surtout s’il n’y a pas de supervision centralisée. Ce qui commence par de l’agilité se transforme en coûts dispersés et en infrastructure fragmentée. C’est ce qu’on appelle le « cloud sprawl ».
Les dirigeants réalisent souvent trop tard que des ressources inutilisées ou oubliées leur sont encore facturées. Les équipes de développement lancent des environnements de test et ne les ferment pas. Quelqu’un fork une machine virtuelle qui reste inactive pendant six mois. Multipliez cela par de grandes équipes, et vous dépensez du capital pour des actifs que personne n’utilise ou ne suit.
Cette croissance non gérée des artefacts du cloud, de l’informatique, du stockage, des services, s’aggrave au fil du temps. La visibilité des actifs diminue. Votre équipe financière constate une augmentation de la facture, mais ne peut pas la rattacher à une fonction critique pour l’entreprise. Le nettoyage prend du temps et nécessite un alignement entre l’ingénierie, l’informatique et les finances. Il ne s’agit pas seulement de réduire le gaspillage, mais aussi de rétablir la discipline.
La solution n’est pas d’interdire le cloud. Elle consiste à créer une gouvernance de l’infrastructure qui fonctionne à l’échelle, des contrôles partagés, des audits automatisés des coûts et une responsabilisation. Si vous ne savez pas ce qui est déployé et où, vous ne gérez pas l’infrastructure, vous financez l’inefficacité à l’échelle.
Si vous êtes à la tête d’une entreprise où des dizaines d’équipes déploient une infrastructure cloud sans coordination, vous êtes probablement en train de perdre de l’argent. La prolifération des clouds n’est pas due à l’incompétence. C’est le résultat d’une vitesse sans politique. Les dirigeants doivent rétablir la structure avant de décider s’il faut rapatrier, optimiser l’utilisation du cloud, ou les deux. Le coût caché n’est pas l’infrastructure elle-même, mais la perte de clarté architecturale.
Les frais de sortie des données sont des pièges à coûts cachés qui compliquent les stratégies de sortie du cloud.
Il est facile de déplacer les choses dans le cloud. C’est en les déplaçant que vous rencontrez des difficultés, en particulier au niveau de votre bilan. Ces frictions sont connues sous le nom de frais de sortie, et elles ne sont pas toujours évidentes. Souvent, les entreprises ne se rendent pas compte du montant qu’elles devront payer pour transférer des données hors d’un cloud public jusqu’à ce qu’elles tentent de le quitter ou de se restructurer.
Ces frais créent un effet d’enfermement. Plus vos ensembles de données sont importants et plus vos applications reposent sur des mouvements de données à grande échelle, plus la sortie devient douloureuse. Et ce n’est pas une hypothèse. Antoine Jeol, cofondateur chez Holori, a publié des estimations publiques en 2023 montrant que les principaux fournisseurs de cloud facturaient de manière significative le déplacement de 50 To de données, des coûts qui peuvent rapidement grimper si vous migrez plusieurs systèmes.
Oui, certains fournisseurs de cloud ont renoncé ou réduit les frais d’egress en 2024, mais ces politiques sont pleines de conditions. Par exemple, Microsoft n’offre gratuitement que les premiers 100 Go par mois sur son service Internet Egress, et ce sur son réseau mondial premium. Il ne s’agit pas d’avantages pour les entreprises, mais d’un fil d’Ariane.
Si l’ensemble de vos activités dépend d’une interaction de données à grande échelle, de pipelines internes, d’API externes, de sauvegardes, d’analyses en direct, vous payez probablement trop cher pour le trafic sortant. Et si vous prévoyez de rapatrier ou même de changer de fournisseur, ces frais peuvent retarder ou faire dérailler l’ensemble de votre calendrier.
Si vous êtes directeur technique ou directeur financier, c’est le genre de coût qui mine votre flexibilité à long terme sans que vous vous en rendiez compte avant qu’il ne soit trop tard. Chaque entreprise devrait modéliser les coûts de sortie potentiels dans le cadre de l’évaluation de son infrastructure, même si elle ne prévoit pas de migrer aujourd’hui. Vous ne voulez pas découvrir que vous êtes pris au piège lorsque vous devez faire face aux limitations des fournisseurs ou à des changements stratégiques.
Les migrations traditionnelles « lift and shift » ont conduit à des inefficacités qui favorisent le rapatriement.
De nombreuses entreprises sont passées au cloud sous la pression, les délais, la croissance, l’ambition, mais l’ont fait sans repenser leurs systèmes pour une architecture cloud-native. Au lieu de repenser la façon dont les applications devraient fonctionner dans les environnements cloud, elles ont soulevé leurs charges de travail existantes et les ont déposées dans le nouvel environnement sans y toucher. C’est ce qu’on appelle le « lift-and-shift ».
Le problème ? Cette approche réintroduit d’anciennes inefficacités dans un système qui facture sur la base de l’utilisation. Les applications héritées n’ont pas été conçues pour évoluer en tenant compte des modèles de coûts du cloud. Elles deviennent donc rapidement coûteuses, en s’exécutant en continu, en surconsommant l’informatique et le stockage, et en passant à côté des avantages liés aux performances cloud-natives, comme l’informatique sans serveur ou l’autoscaling qui réagit en fonction du trafic, et non de suppositions.
Le refactoring pour être véritablement cloud-native est souvent mis de côté en raison de son coût et de sa complexité perçus. Mais l’éviter conduit à une infrastructure gonflée, à une agilité réduite et à un comportement imprévisible en matière de coûts. Au fil du temps, les entreprises commencent à se demander si ces applications, qui n’ont de toute façon jamais vraiment correspondu au modèle du cloud, y ont leur place.
C’est là que le rapatriement prend tout son sens, lorsque les coûts deviennent élevés, que les performances se stabilisent et que vous réalisez que l’application n’a jamais eu besoin d’un tel niveau de frais généraux dans le cloud.
Les dirigeants doivent cesser de considérer la migration vers le cloud comme une simple case à cocher. Lift-and-shift peut vous permettre d’y arriver rapidement, mais si vous n’êtes pas prêt à investir dans l’adaptation de l’architecture, vous paierez en fait des tarifs de cloud pour des performances sur site. Prenez la décision intentionnellement, réarchitecturez pour le cloud ou déplacez les charges de travail coûteuses et peu changeantes vers des environnements que vous pouvez contrôler et prévoir.
Les problèmes de sécurité, de conformité et de performance motivent également le rapatriement du cloud
Le coût n’est pas le seul facteur de rapatriement. Pour certaines industries, opérer dans des environnements de cloud public introduit de véritables frictions, non seulement financières, mais aussi réglementaires et opérationnelles. Certaines juridictions imposent la résidence des données, ce qui signifie que certaines données doivent être physiquement stockées dans des pays spécifiques. Les régions de cloud public ne s’adaptent pas toujours à ces règles.
La sécurité devient également une préoccupation à mesure que les entreprises s’agrandissent et que l’infrastructure touche davantage de services critiques. Si les fournisseurs de cloud proposent des contrôles de sécurité robustes, ils s’appuient sur des modèles de responsabilité partagée. Cela n’est pas toujours suffisant dans le cadre de régimes de conformité stricts ou d’exigences d’audit interne.
Les performances sont également importantes. Certaines applications ne bénéficient pas d’une distribution globale. Si la latence, l’acheminement des paquets ou la communication entre services sont incohérents à l’échelle, la localisation des charges de travail peut stabiliser l’efficacité. Les interruptions de service ou les perturbations régionales, fréquentes dans les grands clouds multitenants, peuvent également nuire aux opérations, ce que le directeur financier et le directeur de la technologie remarquent tous deux.
L’étude de Citrix le confirme. Outre les coûts, les entreprises rapatrient les charges de travail en raison de problèmes de conformité inattendus, de l’incapacité à répondre aux attentes internes en matière de performances et de pannes. Ces facteurs, bien que moins visibles qu’un pic de facturation, sont tout aussi convaincants une fois qu’ils commencent à avoir un impact sur les clients et les revenus.
Pour les conseils d’administration et les dirigeants, le rapatriement n’est pas seulement une question technique. Il s’agit d’une question de gestion des risques. Si les décisions en matière d’infrastructure vous empêchent d’accéder à un marché réglementé ou augmentent l’exposition à la sécurité, vous prenez des responsabilités, et pas seulement des inefficacités. Le rapatriement devient une protection stratégique lorsque vous avez besoin d’un contrôle absolu sur l’emplacement des données, sur la manière dont elles se déplacent et sur la façon dont elles sont protégées.
Les caractéristiques de la charge de travail déterminent la pertinence du rapatriement
Toutes les charges de travail n’ont pas leur place dans le cloud. Voilà pour la version simple. La vérité plus complexe est que certaines charges de travail évoluent de manière plus prévisible, consomment des ressources fixes sur de longues périodes et ne bénéficient pas de la flexibilité de l’infrastructure cloud. À un moment donné, pour ces applications, il devient plus coûteux de louer que de posséder.
Lorsque les charges de travail sont lourdes en termes de stockage, de sauvegardes de données, d’archives répliquées, de systèmes de journalisation ou d’ensembles de données volumineux, les coûts de stockage dans le cloud ne restent pas insignifiants. Par exemple, 37Signals a découvert qu’environ 1,5 million de dollars de sa facture annuelle AWS de 3,2 millions de dollars en 2022 provenait uniquement du stockage Amazon S3. Il ne s’agit pas d’une augmentation soudaine du trafic, mais d’un coût de stockage constant. Pour remédier à cette situation, l’entreprise est déjà en train de faire évoluer des produits clés tels que Basecamp et HEY vers un modèle sur site.
Les activités de calcul et de réseau se comportent également différemment au fur et à mesure que les entreprises se développent. Si votre utilisation des ressources est prévisible et que l’élasticité du cloud ne permet pas d’obtenir des performances mesurables, vous payez pour une flexibilité que vous n’utilisez pas. Dans ce cas, la propriété d’une infrastructure, sur site ou en colocation, peut transformer les coûts variables en coûts linéaires plus faciles à gérer.
Cela ne signifie pas qu’il faille tout retirer du cloud. Il s’agit de comprendre ce qui fonctionne le mieux à un endroit donné et d’aligner le placement de l’infrastructure sur la rentabilité, et non sur les décisions informatiques prises en fonction des tendances.
En tant que dirigeant, vous devez insister sur l’analyse détaillée de la charge de travail. Les équipes techniques peuvent préférer la commodité du cloud à l’efficacité. Votre tâche consiste à lier chaque décision d’architecture à l’impact financier et au retour sur investissement en termes de performances et de coûts. Certaines charges de travail s’amortissent d’elles-mêmes dans le cloud. D’autres ne font qu’accumuler les dépenses. Sachez faire la différence et établissez vos priorités en conséquence.
Le rapatriement devient de plus en plus rentable à mesure que les organisations se développent
Les modèles de tarification du cloud sont optimisés pour les startups, les petites équipes et les environnements à faible utilisation, et ce pour une bonne raison. Dans les premières phases d’un produit ou d’une entreprise, l’agilité compte plus que la répartition des coûts. Mais à mesure que les organisations mûrissent et que les systèmes deviennent plus prévisibles, ces modèles de tarification commencent à perdre leur avantage.
À l’échelle, les factures du cloud n’augmentent pas de façon linéaire, mais souvent de façon exponentielle, en particulier lorsque l’expansion est liée à une architecture non optimisée, à la prolifération du cloud et à des modèles de ressources toujours disponibles. Les dépendances, la charge du réseau, le trafic API et la rétention du stockage s’empilent rapidement. À 10 000 dollars par mois, c’est peut-être du bruit. À 1 million de dollars par an, c’est un problème qui ne peut être ignoré.
Au fur et à mesure que l’entreprise se développe, les investissements dans le matériel, la colocation et l’infrastructure dédiée permettent de rentabiliser le capital. Vous dépensez au départ et, en échange, vous devenez propriétaire d’une pile de ressources qui ne fluctue plus en fonction du calendrier d’utilisation ou d’erreurs de configuration. Même en tenant compte des coûts de personnel, des ingénieurs chargés de la mise en œuvre, de la maintenance et de l’optimisation des systèmes, vous êtes souvent gagnant sur le plan du coût total de possession à long terme.
Ce niveau de contrôle ne peut pas être reproduit dans une configuration de cloud multitenant. L’automatisation du cloud est utile, mais elle ne remplace pas la propriété et la personnalisation de l’architecture lorsque vous opérez à l’échelle de l’entreprise.
Les directeurs financiers et les directeurs techniques devraient s’aligner dès le départ sur les prévisions de charge de travail et d’utilisation. Ce qui semble rentable dans le cloud aujourd’hui ne le sera plus plus tard si l’utilisation devient importante et prévisible. Ne partez pas du principe que la mise à l’échelle dans le cloud restera rentable en pilotage automatique. Planifiez vos points d’inflexion à l’avance, modélisez le moment où le rapatriement l’emporte sur la location et agissez avant d’être enfermé dans des structures de coûts qui étouffent l’efficacité à long terme.
Les pressions liées à la réglementation et à la conformité peuvent nécessiter de s’éloigner des services de cloud public
Si votre secteur d’activité est soumis à une réglementation stricte (finance, santé, administration, défense), vous ne pouvez pas vous permettre d’ambiguïté quant à l’emplacement de vos données ou à la manière dont elles sont traitées. Les lois sur la souveraineté des données exigent souvent que les données sensibles soient stockées à l’intérieur de frontières nationales ou régionales spécifiques. Le cloud public n’offre pas toujours ce niveau de contrôle.
La plupart des fournisseurs de cloud exploitent des réseaux mondiaux, mais leurs centres de données régionaux ne couvrent pas forcément toutes les obligations de conformité. Et même lorsqu’ils le font, il n’est pas toujours simple de vérifier et d’appliquer les contrôles aux niveaux physique et logique. Les auditeurs, les régulateurs et les parties prenantes internes attendent des preuves, et pas seulement des assurances de la part du fournisseur.
Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, le risque commercial augmente. C’est là que le rapatriement ou l’infrastructure hybride devient plus qu’un exercice d’optimisation, mais une nécessité de conformité. Vous concevez l’environnement de manière à ce qu’il réponde aux mandats externes, et pas seulement aux préférences internes. Vous protégez ainsi votre accès au marché et réduisez l’incertitude juridique liée aux données sensibles.
Au-delà de la géographie, certaines entreprises réglementées préfèrent également une plus grande transparence opérationnelle, afin de comprendre chaque étape du traitement des données, des protocoles de sécurité et de l’accès des utilisateurs. Les fournisseurs de cloud fonctionnent selon des modèles de responsabilité partagée. Mais parfois, le partage ne suffit pas.
Une évaluation structurée et en plusieurs étapes est essentielle à la réussite d’une stratégie de rapatriement.
Retirer les charges de travail du cloud sans plan d’action pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Le rapatriement du cloud exige une approche délibérée et en plusieurs phases, en commençant par la visibilité, suivie d’une analyse détaillée de la charge de travail, de la sélection de l’infrastructure, de l’alignement technologique et de l’exécution.
La première étape consiste à réaliser un audit complet, ligne par ligne, des dépenses liées au cloud. Il ne s’agit pas seulement de savoir combien vous payez, mais aussi où et pourquoi. Décomposez les couches de stockage, de calcul et de réseau. Examinez les services sous-utilisés. Identifiez les actifs « zombies » qui génèrent encore des coûts. Les signaux de coûts vous indiquent où se cachent les inefficacités.
À partir de là, évaluez l’adéquation de la charge de travail. Déterminez les applications et les services qui nécessitent de la flexibilité par rapport à ceux dont la demande est fixe et stable. Les systèmes prévisibles, tels que la réplication du stockage, les API internes ou les planificateurs de tâches, peuvent offrir un meilleur retour sur investissement lorsqu’ils sont déplacés sur site ou en colocation.
Ensuite, vous devez choisir entre le rapatriement hybride et le rapatriement complet. Les modèles hybrides permettent aux apps critiques et orientées client de rester dans le cloud tout en déplaçant les charges d’arrière-plan vers l’infrastructure physique. Cet environnement divisé réduit la pression sur les coûts tout en maintenant les performances là où elles sont importantes.
Ensuite, examinez votre pile, le replatforming ou le passage à des piles technologiques open-source comme Linux, Kubernetes ou OpenStack peut réduire la dépendance à l’égard des plates-formes propriétaires. Cela minimise le verrouillage des fournisseurs et permet aux équipes qualifiées d’opérer dans des écosystèmes avec une plus grande flexibilité et des coûts de licence plus faibles.
Enfin, élaborez un plan de migration comprenant des délais réalistes pour le déplacement des données, l’installation du matériel, la formation du personnel et les éventualités de retour en arrière. Les frais de sortie et le séquençage deviennent des facteurs opérationnels. Le rapatriement ne consiste pas seulement à quitter le cloud, mais aussi à le faire avec un minimum de perturbations et un maximum de contrôle.
Les dirigeants doivent traiter le rapatriement comme un investissement, qui exige une clarté initiale, un retour sur investissement mesurable et une exécution bien structurée. Tout déplacement d’infrastructures critiques a des implications en termes de performances, de risques et de délais. Les raccourcis sont coûteux. Investissez le temps nécessaire pour aligner la stratégie technologique sur les objectifs financiers et réglementaires, et responsabilisez chaque phase.
Les infrastructures hybrides sont appelées à devenir le modèle à long terme de l’informatique d’entreprise.
À mesure que les stratégies d’infrastructure mûrissent, la plupart des entreprises s’orientent vers des environnements hybrides, non pas parce que le cloud est un échec, mais parce que la réalité opérationnelle est plus complexe qu’une solution à plateforme unique. Les entreprises recherchent à la fois la performance, le contrôle et la rentabilité. L’hybride leur permet d’équilibrer ces priorités.
Certaines charges de travail, les plateformes orientées client, les applications distribuées à l’échelle mondiale, les services dont la demande est imprévisible, fonctionnent toujours bien dans le cloud. Vous évoluez de manière réactive et vous vous rapprochez de vos utilisateurs. Mais les opérations de back-end, le traitement par lots, les systèmes à forte capacité de stockage et les outils internes ont souvent intérêt à retourner dans des environnements de colocation ou sur site, où les performances sont prévisibles et la facturation contrôlable.
Le matériel a rattrapé son retard. Aujourd’hui, les entreprises peuvent déployer des unités centrales de haute performance, des serveurs à grand cœur et des équipements de réseau optimisés dans des configurations compactes et puissantes. Les centres de colocation permettent d’étendre l’infrastructure sans avoir à posséder un centre de données complet. Vous n’avez pas à construire l’alimentation et le refroidissement, vous louez la capacité et vous apportez votre architecture.
Cette orientation n’est pas théorique. Selon une enquête CIO Cloud Trends Survey réalisée par Azul, 22 % des DSI prévoient de rapatrier certaines charges de travail, et 17 % ont l’intention de retarder ou d’annuler des projets cloud pour gérer les coûts. Parallèlement, le rapport State of the Cloud de Flexera a révélé que 21 % des charges de travail et des données ont déjà été rapatriées depuis des environnements de cloud public. Il ne s’agit pas de décisions isolées, elles reflètent un réalignement croissant de la stratégie informatique des entreprises.
Si vous menez une stratégie d’infrastructure à grande échelle, il n’est pas nécessaire de considérer le cloud et l’infrastructure sur site comme des cadres opposés. Ce sont des outils. La bonne combinaison dépend de vos modèles de charge de travail, de vos modèles de coûts et des exigences de vos clients. Ce qui compte, c’est de créer un environnement dans lequel chaque charge de travail s’exécute de la manière la plus efficace, la plus sûre et la plus performante possible, sans contraintes de fournisseurs ni surprises budgétaires.
Le rapatriement du cloud signifie une stratégie informatique en cours de maturation, centrée sur la rentabilité et le contrôle opérationnel
Il y a quelques années, l’adoption du cloud était un facteur de différenciation concurrentielle. Aujourd’hui, c’est tout simplement la norme. Cette évolution signifie que les entreprises doivent repenser leurs stratégies en matière de cloud, non pas en fonction d’un battage médiatique ou de décisions héritées du passé, mais en fonction des objectifs commerciaux actuels.
Lorsque les entreprises ont adopté le cloud pour la première fois, elles se trouvaient dans des phases de forte croissance et de forte vélocité. Le besoin était la rapidité. Mais la croissance change l’équation. Lorsque les systèmes se stabilisent, les coûts deviennent plus visibles. Les défauts de l’architecture, la dépendance excessive à l’égard des systèmes propriétaires et l’absence de contrôle des coûts à long terme commencent à éroder la proposition de valeur initiale.
Le rapatriement est ce qui vient ensuite lorsque les dirigeants commencent à poser des questions plus difficiles : que payons-nous réellement, et est-ce aligné sur la performance ? Pouvons-nous contrôler l’orientation de l’infrastructure sans attendre la feuille de route d’un fournisseur ? Comprenons-nous et maîtrisons-nous les risques liés aux pannes, aux changements de prix ou aux interruptions de service ?
Nombreux sont ceux qui répondent aujourd’hui à ces questions en remettant les charges de travail sous contrôle direct. Il ne s’agit pas d’une démarche réactive. C’est méthodique. C’est ce qui se produit lorsque l’infrastructure évolue en fonction de la maturité de l’entreprise.
Les dirigeants devraient considérer le rapatriement non pas comme un renversement de tendance, mais comme une évolution naturelle. Les décisions stratégiques ne portent pas sur l’emplacement des charges de travail, mais sur la manière dont ces charges de travail répondent aux besoins actuels de l’entreprise. Le cloud a rempli sa mission. Désormais, l’accent est mis sur la précision, l’efficacité et l’autonomie. Le rapatriement reflète simplement ce changement.
Le bilan
Si la dernière décennie a consisté à se lancer rapidement dans le cloud, la prochaine consistera à prendre du recul et à faire des choix d’infrastructure plus intelligents. Le cloud résout toujours de vrais problèmes, l’évolutivité, la vitesse de déploiement, la portée mondiale, mais ce n’est pas une solution unique. L’évolution des entreprises s’accompagne de celle de leurs priorités opérationnelles. L’efficacité commence à compter plus que la commodité.
Le rapatriement ne consiste pas à rejeter le cloud. Il s’agit d’en exiger une valeur plus claire. Les dirigeants ne s’éloignent pas de l’architecture moderne, ils se dirigent vers l’alignement. Un alignement opérationnel, financier et réglementaire.
C’est là que la maturité se manifeste. Vous savez ce dont vos systèmes ont besoin, ce que vos équipes peuvent gérer et ce que votre entreprise est prête à payer pour la flexibilité. L’intérêt n’est pas de suivre les tendances, mais de mettre en place une infrastructure qui soutienne l’entreprise sans remettre en cause chaque facture. Lorsque l’équation n’a plus de sens, vous la réécrivez.
Les entreprises qui gagneront à long terme seront celles qui construiront sur l’intention, et non sur l’inertie. Les coûts, le contrôle, la conformité, rien de tout cela ne doit être envisagé après coup. Ce sont des décisions. Et c’est maintenant qu’il faut les prendre délibérément.