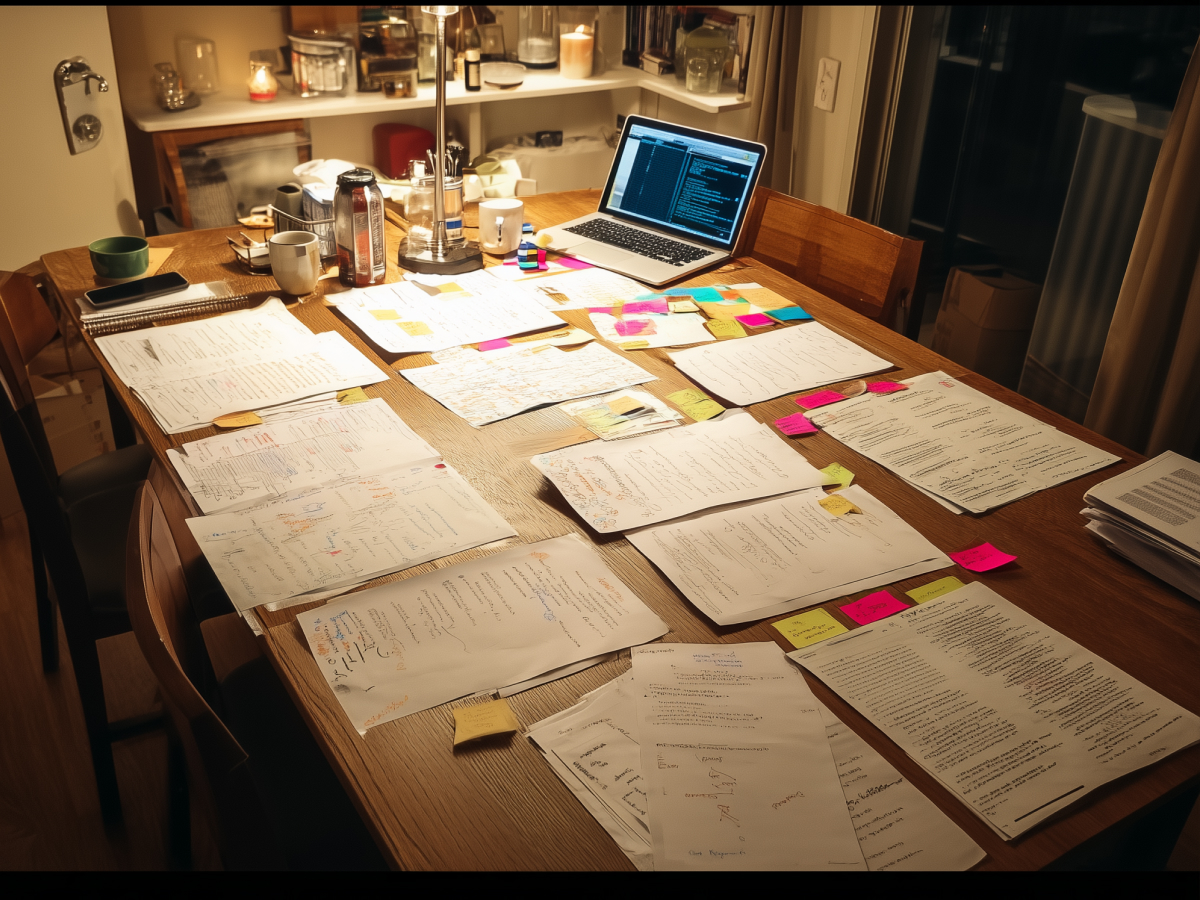Les systèmes existants nuisent à l’efficacité, à la sécurité et à l’évolutivité.
La plupart des entreprises utilisent encore des systèmes centraux basés sur des logiciels construits il y a plusieurs dizaines d’années. Ces systèmes existants étaient solides à l’époque. Ils fonctionnent toujours. Mais ils ne sont pas évolutifs, ils sont fragiles et ils ralentissent le progrès. Ils n’ont pas été conçus pour le rythme de changement d’aujourd’hui, ni pour l’incertitude de demain.
La maintenance de ces systèmes coûte de plus en plus cher chaque année. Le code est souvent personnalisé, avec une documentation limitée ou inexistante. Dans de nombreux cas, un ou deux employés seulement savent encore comment il fonctionne. S’ils partent, ces connaissances disparaissent. Ce n’est pas un modèle durable pour une entreprise.
La sécurité est un autre problème. Les plates-formes existantes ne sont pas avec les modèles de menace actuels. Les correctifs sont manuels. La compatibilité avec les protocoles et les outils modernes est limitée, voire inexistante. Cela signifie plus de vulnérabilités et plus d’exposition au risque.
Et puis il y a la question de l’intégration. Les plateformes existantes n’aiment pas communiquer avec les systèmes plus récents. Vous avez des équipes qui perdent des heures en transferts manuels de données et en corrections ponctuelles, simplement pour que le flux de travail continue à fonctionner. Cela ne suffit plus.
Les dirigeants doivent comprendre une chose : l’important n’est pas l’âge du système, mais de savoir s’il freine l’activité de l’entreprise. C’est le cas de la plupart des applications patrimoniales. Si vous les conservez suffisamment longtemps, elles plafonneront votre croissance.
La modernisation des applications permet d’améliorer les performances, de réduire les coûts et d’accroître la souplesse.
Moderniser votre technologie ne signifie pas qu’il faille tout jeter. Il ne s’agit pas non plus de perdre des mois à planifier. Ce qui compte, c’est de procéder à une mise à niveau ciblée. Vous ne vous contentez pas de réécrire du code, vous regagnez du temps pour vos équipes, vous améliorez les performances et vous supprimez les inefficacités liées à l’héritage.
Les systèmes modernisés peuvent évoluer à la demande. Cela signifie que vous n’avez pas à deviner la quantité d’infrastructure dont vous aurez besoin au cours du prochain trimestre. Vous utilisez ce dont vous avez besoin, rien de plus. Et lorsque les clients attendent de la rapidité, vous répondez plus rapidement, car vos systèmes ne sont plus le goulot d’étranglement.
La maintenance est moins coûteuse. Les mises à jour prennent des heures, pas des semaines. Et les développeurs ne sont pas coincés à résoudre des problèmes causés par des frameworks obsolètes, ils construisent de nouvelles fonctionnalités que vos équipes et vos clients souhaitent réellement.
L’entreprise évolue également plus rapidement. Vous pouvez vous connecter à des plateformes modernes, lancer des services numériques plus rapidement et exécuter des opérations hybrides sur le cloud et sur site avec beaucoup moins de frictions. Cette rapidité donne aux entreprises un avantage concurrentiel.
Pour les dirigeants, l’objectif est clair : les systèmes modernes ne sont pas seulement plus efficaces, ils rendent l’ensemble de l’entreprise plus agile et mieux préparée à gérer les changements, qu’ils soient liés au marché ou à la réglementation.
Une approche progressive utilisant le cadre des « 7 r » permet d’aligner la stratégie de modernisation sur les résultats de l’entreprise.
Il n’est pas nécessaire de tout moderniser en même temps. En fait, vous ne devriez pas. Les stratégies les plus efficaces sont échelonnées, planifiées et adaptées au fonctionnement de vos systèmes et aux besoins réels de votre entreprise. C’est là qu’interviennent les « 7 R » : Rehost, Replatform, Refactor, Rearchitect, Rebuild, Replace et Encapsulate. Il ne s’agit pas d’étiquettes, mais de voies d’exécution. Choisissez-en un en fonction de ce que fait le système, de sa criticité et de la flexibilité de la base de code et de l’infrastructure.
Le rehosting consiste à passer à une infrastructure plus moderne avec le moins de changements possible. C’est rapide. Elle permet de gagner du temps. La replatformisation modifie l’environnement d’hébergement mais conserve la majeure partie de l’application intacte. Il s’agit d’une optimisation sans perturbation. Le remaniement améliore la structure interne du code sans toucher à la fonction principale. C’est une bonne chose lorsque le système fonctionne mais que sa maintenance demande trop d’efforts.
Pour les systèmes engorgés, la réarchitecture ouvre la voie à l’évolution et à l’intégration en faisant évoluer l’architecture vers quelque chose de plus actuel, des microservices, par exemple. La reconstruction est plus invasive : vous reconstruisez le système à partir de zéro. C’est coûteux, mais parfois nécessaire lorsqu’il n’y a pas d’autre option. Remplacer signifie changer complètement de système, généralement avec une solution commerciale ou SaaS. Et si vous n’êtes pas prêt à tout démonter, l’encapsulation vous permet de construire une interface autour de l’ancien système afin qu’il puisse fonctionner avec des plateformes plus récentes à l’aide d’API.
La clé est l’adaptabilité. Les stratégies de modernisation varient en fonction de l’âge du système, du budget, de la sécurité et des objectifs de l’entreprise. Cette flexibilité permet aux dirigeants de concentrer les ressources là où l’entreprise obtient le meilleur rendement, avec moins de risques et plus de clarté sur l’impact.
Les décisions concernant le choix du « R » à utiliser ne devraient pas incomber uniquement aux services informatiques. L’impact sur l’activité, la continuité et l’expérience de l’utilisateur doivent faire partie de la discussion. Il est normal d’avoir plusieurs « R » en jeu dans différents systèmes. La véritable transformation se produit lorsque ces choix s’alignent sur la vélocité et les objectifs de croissance de l’entreprise.
Une feuille de route de modernisation réussie commence par un audit des systèmes actuels
Avant de moderniser, vous avez besoin d’une visibilité totale. Vous devez comprendre chaque système en jeu, ce qu’il fait, qui l’utilise, comment il fonctionne, ce qu’il coûte et quelles sont les dépendances qui y sont liées. Sans cet audit, vous ne faites que deviner. Cela crée des risques, fait perdre du temps et conduit à de mauvais résultats.
Deuxièmement, évaluez la faisabilité technique. Tout n’est pas prêt à être transféré. Certains systèmes peuvent présenter de graves problèmes de sécurité. D’autres peuvent contenir des intégrations codées en dur qui se cassent à la seconde où vous les touchez. Vous devez connaître ces limites dès le début pour éviter des perturbations majeures en milieu de projet. Évaluez l’état technique et établissez vos priorités, en vous concentrant d’abord sur ce qui apporte le plus de gains opérationnels ou stratégiques.
Ensuite, il ne s’agit pas d’un projet exclusivement informatique. La modernisation nécessite la contribution de l’ensemble de l’entreprise. Vous devez impliquer très tôt les opérations, les finances, les produits et la sécurité. Il ne s’agit pas de parties prenantes passives, mais d’acteurs qui façonnent la réussite du projet. L’alignement interfonctionnel réduit la résistance, garantit l’adoption et lie la modernisation aux résultats de l’entreprise dès le départ.
Une fois que vous avez compris les systèmes et que vous vous êtes mis d’accord sur les priorités, établissez une feuille de route claire. Définissez ce que vous entendez par « fait ». Fixez des objectifs de performance qui comptent, vitesse du système, temps de fonctionnement, coût, habilitation de l’utilisateur. Procédez par étapes. Personne ne tire profit d’un déploiement en bloc. Menez des projets pilotes, recueillez les réactions, mesurez les progrès, ajustez les courbes.
La réussite dépend moins des outils que vous choisissez que de la manière dont vous alignez les personnes et les processus. De nombreux projets échouent non pas parce qu’ils sont techniquement impossibles, mais parce qu’il n’y a pas de vision commune. Si vous alignez les parties prenantes dès le début, l’exécution proprement dite sera nettement plus efficace.
Les efforts de modernisation sont confrontés à des défis tels que la dette technique, la migration de données complexes, les problèmes d’intégration et les lacunes en matière de compétences.
La modernisation est utile, mais elle n’est pas automatique. Il existe de véritables défis, et les ignorer ralentit les progrès ou entraîne des échecs. Le premier est la dette technique. Au fil des années de corrections urgentes et de solutions de contournement temporaires, de nombreux systèmes existants accumulent de la complexité. Le code devient rigide et difficile à mettre à jour. Même l’identification des points de rupture d’un changement peut prendre des semaines. Le remaniement ou la réarchitecture peuvent aider, mais ce travail prend du temps et exige une planification précise.
Et puis, il y a les données. Les applications patrimoniales stockent souvent des données dans des formats obsolètes, des emplacements fragmentés ou des structures incohérentes. La migration de ces données sans perte d’intégrité ni rupture de la logique d’entreprise nécessite une cartographie minutieuse, des tests réels et, souvent, des outils ou des consultants tiers. Une migration précipitée ruine la confiance dans le nouveau système. Faites-le correctement ou retardez le déploiement.
L’intégration est un autre obstacle. De nombreux systèmes existants sont étroitement liés à d’autres outils par le biais de connexions personnalisées conçues pour des flux de travail plus anciens. Si vous modernisez une partie sans comprendre les connexions, vous risquez une instabilité de l’ensemble du système. Plus la structure est monolithique, plus il est difficile d’isoler et de moderniser un seul domaine. Démêler ces liens demande du temps et de la coordination entre les équipes.
Le facteur humain joue également un rôle important. Les équipes existantes peuvent être spécialisées dans les systèmes existants mais ne pas connaître les outils et les architectures utilisés dans les environnements modernes. Le renouvellement des compétences est inévitable. En l’absence de formation ou de nouvelles embauches, l’écart entre les capacités et les besoins s’accroît. Et si les dirigeants sous-estiment l’effort ou ne le planifient pas, la productivité chutera au milieu de la transition.
Ces défis ne sont pas purement techniques. Ils ont un impact sur les budgets, le recrutement, la stabilité des équipes et la satisfaction des clients. En les abordant dès le départ, en particulier en ce qui concerne la requalification et les dépendances entre systèmes, le processus de modernisation devient mesurable, continu et beaucoup moins perturbant.
Tirer parti de technologies telles que l’informatique Cloud, les conteneurs, les API, les microservices et DevOps.
Les systèmes modernes fonctionnent en temps réel, s’adaptent instantanément et se connectent à tout ce qui est nécessaire. Pour cela, il faut faire les bons choix en matière d’infrastructure. L’informatique Cloud donne aux entreprises la possibilité d’augmenter ou de réduire les ressources en fonction de la demande réelle. Il réduit la dépendance à l’égard de l’infrastructure physique et permet aux équipes d’accéder à des services gérés qui accélèrent le déploiement, la surveillance et la mise en œuvre de la sécurité.
Les conteneurs rendent le déploiement cohérent. Vous n’avez pas à vous soucier de savoir si une application s’exécute de la même manière sur les sites de développement, de mise à disposition ou de production. C’est le cas. Les conteneurs regroupent tous les éléments afin d’éliminer cette variabilité. Les API fournissent une structure, des moyens bien définis pour que les services communiquent. Si un problème survient, il est isolé. Si quelque chose de nouveau doit être ajouté, il peut être connecté rapidement sans modifier tous les autres composants.
Les microservices poussent ce concept plus loin. Vous divisez les applications en services indépendants qui peuvent être mis à jour ou remplacés sans interrompre l’ensemble du système. Cela accélère l’innovation. Les équipes de développement et les opérations travaillent en permanence pour améliorer les versions, tester plus rapidement et résoudre les problèmes en temps réel, et non pas après de grands écarts entre les versions.
Il ne s’agit pas de mots à la mode, mais de composants d’une configuration qui permet aux équipes de construire, de déployer et d’évoluer plus rapidement avec moins de goulots d’étranglement. Si votre pile ne peut pas gérer ce niveau de réactivité, elle ralentit tout ce que votre entreprise essaie de livrer.
Les dirigeants n’ont pas besoin de mémoriser les termes relatifs au cloud, mais ils doivent en comprendre les résultats. Les architectures modernes réduisent le verrouillage des fournisseurs, accélèrent l’intégration et éliminent les retards coûteux en cas d’augmentation de la demande des utilisateurs. Elles permettent également aux équipes de travailler de manière indépendante, ce qui est essentiel dans les entreprises internationales qui gèrent des opérations en temps réel.
Succès de la modernisation
Il n’y a qu’une seule façon de savoir si votre stratégie de modernisation fonctionne : les chiffres. Pas des suppositions. Pas des opinions. Des mesures concrètes. Commencez par les performances. Les systèmes sont-ils plus rapides ? Le temps de fonctionnement s’améliore-t-il ? Les temps de réponse sont-ils plus courts ? Vous devriez être en mesure d’établir clairement un avant et un après. Si votre équipe continue à rechercher les pannes et à escalader les tickets, c’est que quelque chose ne va pas.
Examinez ensuite les coûts. Vous devriez constater une réduction des coûts d’infrastructure et d’assistance. Les systèmes modernes nécessitent moins d’interventions manuelles. Ils s’adaptent efficacement. Les équipes peuvent effectuer des mises à jour sans geler les opérations ou ouvrir de longs cycles de contrôle des changements. Cette efficacité devrait se refléter dans le budget en l’espace de quelques trimestres.
Suivez ensuite la productivité. Un système modernisé devrait permettre à votre personnel d’en faire plus avec moins de frictions. Les cycles de déploiement devraient se réduire. Les développeurs devraient être en mesure de publier des mises à jour plus rapidement. Les utilisateurs finaux ne devraient pas avoir besoin de solutions de contournement pour accomplir leurs tâches. Si les nouveaux employés sont plus rapidement opérationnels ou si les demandes d’assistance diminuent, vous êtes probablement en train de résoudre de véritables problèmes.
Il y a aussi l’adoption du système. Si votre équipe évite de travailler dans le nouvel environnement et s’accroche aux anciens outils, c’est que quelque chose a échoué sur le plan culturel ou dans la conception de l’interface utilisateur. Un engagement élevé et une faible résistance sont des signes que le système ne fonctionne pas seulement sur le plan technique, mais qu’il apporte une valeur ajoutée au mode de fonctionnement des équipes.
En fin de compte, la modernisation n’est pas seulement une question de santé technique, mais aussi de capacité future. Si la plateforme est conçue pour évoluer sans nécessiter de refonte majeure et que vous pouvez en toute confiance prendre en charge les futurs lancements de produits ou les expansions de marché, c’est que le système fournit ce qu’il est censé fournir.
Les rapports sont importants dans ce domaine. Les dirigeants doivent avoir accès à des mesures régulières, présentées sans bruit. Privilégiez les tendances plutôt que les instantanés. Les performances, les coûts et l’engagement des utilisateurs doivent faire l’objet d’un suivi continu, d’un examen trimestriel et d’un lien direct avec les résultats de l’entreprise. Si les indicateurs de modernisation ne sont pas intégrés aux indicateurs clés de performance de l’entreprise, l’ensemble de l’initiative perd de son intérêt au niveau de la direction.
La modernisation est un processus continu soutenu par des pratiques d’amélioration continue.
La modernisation ne s’arrête pas à la mise en service de nouveaux systèmes. C’est un modèle d’exploitation. Compte tenu du rythme de l’évolution technologique et des exigences des clients, les mises à niveau ponctuelles suivies d’une stagnation n’ont aucune valeur. Les entreprises qui réussissent abordent la modernisation comme un cycle continu, soutenu par des pratiques qui maintiennent l’efficacité, la sécurité et la pertinence des systèmes.
DevOps joue un rôle central. Il brise les silos entre le développement et les opérations, ce qui permet un déploiement plus rapide, une réponse plus rapide aux incidents et des mises à jour plus transparentes. Vous n’attendez pas les versions majeures tous les quelques mois. Les changements se font de manière incrémentale, testés et intégrés en continu, avec des boucles de rétroaction rapides. Les systèmes restent ainsi alignés sur l’utilisation réelle de l’entreprise, sur une base hebdomadaire, voire quotidienne.
CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) garantit que chaque modification apportée par vos développeurs est automatiquement testée et, une fois validée, poussée vers la production. Pas de retard. Pas de risque d’interrompre les environnements de production lors des mises en production. Cette cohérence est essentielle à grande échelle. Elle relie directement la livraison technique au rythme de l’entreprise.
Résultat : les systèmes restent sécurisés, les fonctionnalités sont commercialisées plus rapidement et vos équipes peuvent s’adapter sans interruption. Cela signifie également que le coût des futures mises à niveau reste faible, car vous n’êtes jamais qu’à quelques pas de l’état actuel de la technologie.
De nombreuses entreprises considèrent encore la modernisation comme un projet d’investissement avec un objectif précis. Cet état d’esprit entraîne une stagnation technique avant que l’entreprise ne puisse bénéficier pleinement de l’investissement. Un modèle d’amélioration continue, rendu possible par DevOps et CI/CD, transforme la modernisation en une fonction stratégique à long terme. Les dirigeants responsables de la planification à long terme doivent financer des capacités itératives, et pas seulement des transitions ponctuelles. C’est ainsi que vous éviterez d’être à nouveau à la traîne deux ans après la mise en œuvre.
En conclusion
La modernisation n’est pas seulement une décision informatique, c’est aussi une décision opérationnelle. Elle détermine la vitesse à laquelle vos équipes se déplacent, la sécurité de vos systèmes et la compétitivité de votre entreprise au fil du temps. L’infrastructure existante peut encore fonctionner, mais si elle ralentit l’exécution, épuise les ressources ou crée des risques, elle vous empêche d’avancer.
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de tout remplacer du jour au lendemain. Les organisations les plus intelligentes adoptent une approche progressive et délibérée, alignée sur les priorités, fondée sur des avantages pratiques et soutenue par des équipes interfonctionnelles solides. C’est ainsi que vous réduisez les coûts, augmentez la souplesse et restez en tête sans interruption.
Intégrez la modernisation à votre stratégie à long terme, et non à un projet ponctuel. Construisez des systèmes qui évoluent en même temps que votre entreprise. C’est de là que vient la véritable résilience. C’est ce qui permet d’évoluer.