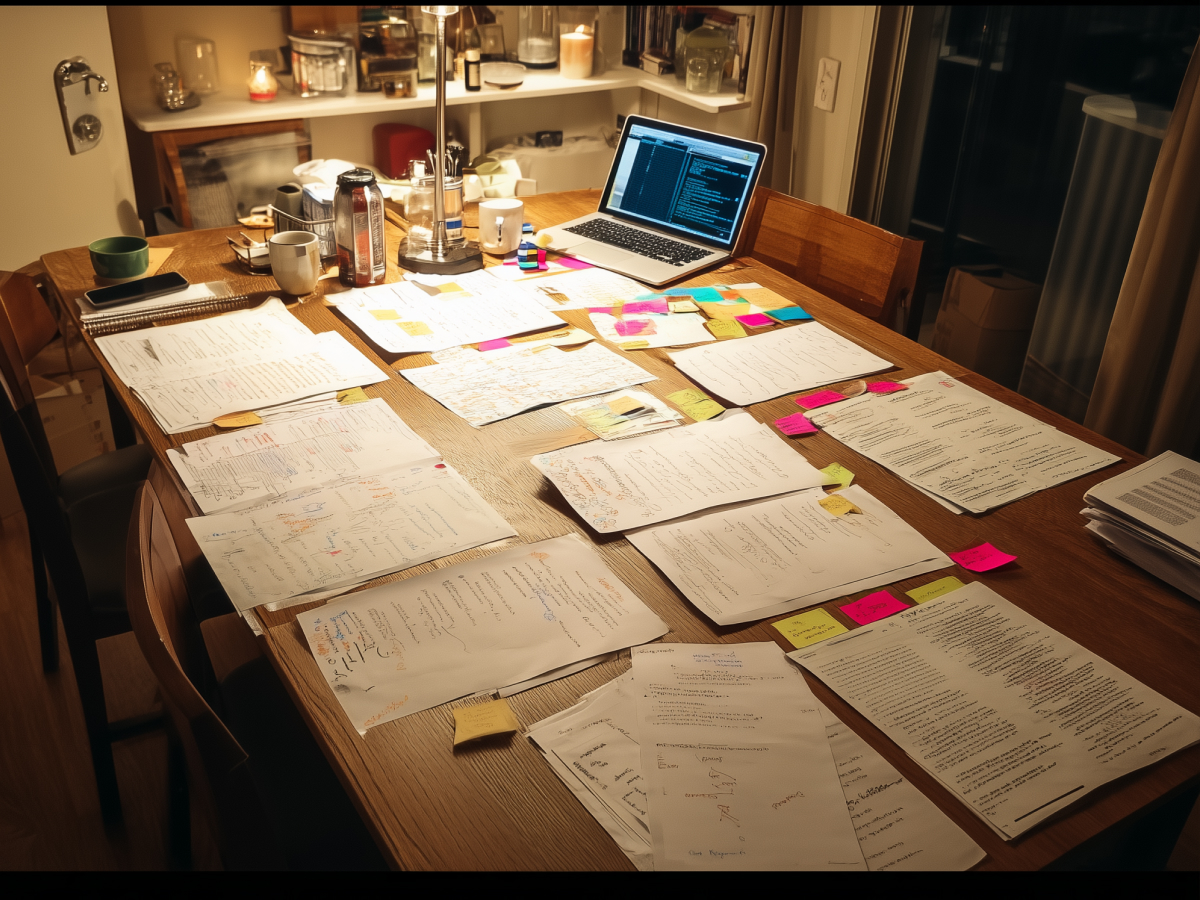Limiter les émissions ne suffit pas, l’adaptation au climat est essentielle à la survie.
Même avec les meilleurs outils de décarbonisation dont nous disposons aujourd’hui, le plus gros du travail reste à faire. Selon les recherches menées par Bain dans quatorze secteurs d’activité, seuls 25 % des émissions des entreprises peuvent être réduites par des méthodes à retour sur investissement positif disponibles à l’heure actuelle. Il reste donc 75 % des émissions sans solution rentable. En d’autres termes, nous ne sommes même pas à mi-chemin de la résolution du volet « émissions » de l’équation climatique.
Cela signifie que nous devons agir sur l’autre moitié de l’équation, l’adaptation. Cessons de considérer la résilience climatique comme le problème de demain. Le changement climatique est déjà en train de modifier les routes commerciales, de créer des pertes financières réelles et de mettre à rude épreuve les systèmes économiques. Les banques centrales intègrent désormais le risque climatique dans leurs modèles. Il est temps que les dirigeants d’entreprise fassent de même.
Vous verrez les perturbations augmenter dans tous les systèmes qui dépendent de la stabilité, de la fabrication, de la logistique, des réseaux d’énergie. Si les chefs d’entreprise attendent que les marges soient directement touchées, vos options seront moins nombreuses, plus coûteuses et essentiellement réactives. Ce qu’il faut, c’est une visibilité précoce et un investissement intelligent pour rester opérationnel en cas de volatilité.
L’adaptation ne consiste pas à se rendre aux dommages inévitables. Il s’agit de faire en sorte que votre entreprise continue à fonctionner et à jouer un rôle de premier plan lorsque d’autres faiblissent. C’est un avantage. C’est la survie.
Le changement climatique perturbe activement les chaînes d’approvisionnement, la disponibilité des matières premières et la productivité de la main-d’œuvre.
Les effets de la volatilité du climat ne sont pas à l’horizon, ils sont déjà là. Les phénomènes météorologiques physiques et les chaleurs extrêmes réduisent la productivité et gonflent les coûts d’exploitation. Les sécheresses en Europe ont réduit la capacité des barges sur des fleuves essentiels comme le Rhin et le Danube. Cela a ralenti le transport maritime et, dans de nombreux cas, a entraîné une réduction de la production. Les infrastructures vieillissent plus rapidement sous l’effet du stress, et il est plus difficile de compter sur les ressources naturelles.
Les cultures se déplacent d’une région à l’autre. Le stress hydrique est plus sévère dans les zones qui soutiennent des parties essentielles du système alimentaire. Les prix des produits de base sont désormais très instables et découplés des schémas d’inflation traditionnels. Prenez le cacao : les prix ont triplé depuis 2022, en partie à cause de la chaleur croissante, de la sécheresse et de la baisse des rendements. Ce type de volatilité met à mal les modèles de prévision et rend l’approvisionnement peu fiable.
Le travail, en particulier le travail physique, est également touché. Avec la hausse des températures, les gens ne peuvent tout simplement plus travailler de la même manière. Certaines régions enregistrent déjà des pertes de productivité de l’ordre de 20 à 30 %, en particulier dans des secteurs tels que l’agriculture et la construction. L’OIT estime que d’ici à 2030, l’équivalent de 80 millions d’emplois à temps plein seront perdus en raison du stress thermique.
Qu’il s’agisse de logistique, de sécurité alimentaire ou des limites physiques du travail humain, ce défi s’étend à tous les secteurs d’activité. Si votre entreprise n’a pas encore été touchée, elle le sera. Ce n’est pas une spéculation, c’est une dynamique statistique.
Le recul des assureurs met en évidence un risque financier plus large lié au changement climatique.
Les marchés de l’assurance s’adaptent rapidement. Le coût des sinistres liés au climat a dépassé des niveaux gérables dans certaines régions. Aux États-Unis, les principaux assureurs se sont retirés ou ont fortement augmenté leurs primes dans des États comme la Floride et la Californie. Pourquoi ? Les incendies de forêt, les ouragans et d’autres phénomènes climatiques ont fait basculer les pertes dans la zone rouge. De nombreuses régions présentent aujourd’hui un risque si élevé qu’elles sont pratiquement inassurables.
Il ne s’agit pas d’un phénomène isolé. Il s’agit d’un changement qui s’opère à l’échelle mondiale. Selon Gallagher Re, 263 milliards de dollars de pertes liées aux catastrophes n’étaient pas assurés en 2024. Cela représente 63 % des pertes économiques totales, soit une majorité. Lorsque les assureurs refusent de souscrire vos risques, il ne s’agit pas seulement d’un problème de contrôle des coûts, mais d’un signal d’alarme. Cela rend le capital plus cher, les contrats plus limités et les structures financières plus exposées.
Si vous êtes directeur financier ou responsable des risques, ces données devraient vous inciter à un examen approfondi. Vous ne pouvez plus compter sur les modèles traditionnels de transfert des risques pour protéger le bilan. Les entreprises qui n’ont pas de stratégies proactives de résilience et d’adaptation porteront ces risques en interne, souvent sans le savoir, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Attendre n’est pas stratégique. Les dirigeants qui agissent avant que le marché ne devienne totalement réactif seront dans une meilleure position financière et opérationnelle. Traiter le risque climatique comme un risque financier n’est plus un débat. Il s’agit d’un processus continu.
Il existe un fossé entre l’importance reconnue de la résilience climatique et l’investissement réel dans ce domaine.
Les dirigeants savent que la résilience climatique est importante. Dans une étude réalisée par Bain en 2024, les responsables des opérations l’ont classée parmi leurs principales priorités stratégiques, juste après la gestion des coûts. C’est encourageant, mais ce qui vient ensuite est encore plus important. À l’heure actuelle, seuls 3 % du total des dépenses d’investissement dans le domaine du climat sont consacrés à l’adaptation et à la résilience. Le secteur privé n’y contribue qu’à hauteur de 7 milliards de dollars.
Il y a un décalage entre ce que croient les dirigeants et ce que montrent les bilans. La raison n’est pas un manque d’intention, mais un manque d’appropriation et de responsabilité. De nombreuses entreprises peinent à justifier le retour sur investissement, en partie parce que les gains de résilience ne sont pas toujours immédiats ou linéaires. Mais les pertes dues aux catastrophes ne le sont pas non plus.
Le problème est en partie dû à la complexité. Les indicateurs de résilience ne sont toujours pas aussi normalisés ou visibles que les indicateurs de performance financière. Cela conduit à considérer l’adaptation comme facultative ou secondaire, même lorsque le coût de l’inaction augmente. Les conseils d’administration veulent une atténuation tangible des risques, mais l’adaptation continue d’être mise de côté dans les cycles de planification.
Les dirigeants qui parviennent à modifier cette équation, ceux qui orientent le capital vers la résilience en fonction de l’exposition factuelle au risque, seront en mesure de réaliser des performances supérieures. Ils ne se contenteront pas d’éviter les pertes. Ils s’assureront des parts de marché dans un environnement instable.
La fragmentation de l’appropriation organisationnelle entrave l’efficacité des efforts de résilience climatique
Le cœur du problème ? Dans la plupart des entreprises, personne n’est vraiment responsable de la résilience climatique. Les équipes chargées du développement durable gèrent les modèles, mais n’ont souvent pas l’autorité nécessaire pour agir. Les directeurs d’exploitation se concentrent sur l’efficacité opérationnelle. Les directeurs financiers voient les coûts initiaux sans retour financier clair. En conséquence, la responsabilité passe d’une fonction à l’autre et rien ne bouge.
Cette lacune structurelle ralentit l’exécution. Elle entraîne des retards dans la prise de décisions cruciales, telles que les investissements à réaliser pour assurer la robustesse de l’entreprise ou la mise en place d’une redondance. La conséquence n’est pas seulement un temps de réaction plus lent, mais aussi des occasions manquées de prévenir les défaillances systémiques en cas de perturbation.
Ce qui fonctionne mieux, c’est d’attribuer une responsabilité directe. Plusieurs entreprises se sont déjà engagées dans cette voie. Elles nomment des responsables de la résilience (CRO) ou mettent en place des conseils dédiés à la résilience climatique ayant l’autorité nécessaire pour transcender les silos, les opérations, les finances, la chaîne d’approvisionnement, afin que les décisions ne soient pas bloquées. Mais les rôles et les titres ne suffisent pas.
La résilience doit apparaître dans les tableaux de bord. Elle doit informer les mêmes décisions et processus qui définissent le succès financier et opérationnel. Un grand fabricant de biens de consommation l’a déjà fait : il suit les vulnérabilités climatiques de ses fournisseurs, les niveaux d’exposition et l’état de préparation aux situations d’urgence. Ces mesures influencent désormais directement les décisions en matière de planification des investissements, d’approvisionnement et d’atténuation des risques. C’est ainsi que l’on comble le fossé de la gouvernance.
Pour les dirigeants qui établissent déjà des rapports en fonction de normes d’audit, il ne s’agit pas de réinventer le modèle de gouvernance. Il s’agit d’intégrer les indicateurs de résilience dans les flux de travail existants afin que les dirigeants puissent réagir aux risques climatiques avec la même rapidité et la même précision qu’à la volatilité des marchés ou à la pression sur les marges.
Une meilleure visibilité des risques permet une adaptation plus intelligente et plus souple et ouvre de nouvelles perspectives commerciales.
Le risque climatique n’est pas toujours là où on le croit. Il n’est pas confiné à l’intérieur de l’entreprise, et sans visibilité interfonctionnelle, la plupart des organisations n’ont pas une vue d’ensemble. Les risques les plus graves se situent souvent au cœur des chaînes d’approvisionnement ou dans des forces macro complexes, telles que les perturbations sociales, l’instabilité géopolitique ou la défaillance de l’infrastructure physique.
Les entreprises qui résolvent ce problème utilisent de meilleurs outils. L’IA, l’analyse géospatiale, les jumeaux numériques et les systèmes d’évaluation de la résilience permettent désormais d’analyser les points de tension bien avant qu’ils ne déclenchent une défaillance. Ces systèmes créent des résultats exploitables, une surveillance des infrastructures critiques, une prédiction des défaillances et une hiérarchisation des actifs.
Une entreprise américaine du secteur de l’énergie utilise l’IA pour détecter les tensions subies par les transformateurs en cas de conditions météorologiques extrêmes. Ces informations précoces lui permettent d’éviter les pannes. Ils n’attendent pas, ils agissent avant que la panne ne se produise. C’est une utilisation fonctionnelle de la visibilité.
Il y a également un potentiel de revenus. Certaines entreprises transforment ces capacités en offres de produits. Un assureur mondial transforme sa vaste base de données sur les risques de catastrophe en services de conseil sur la résilience climatique, en proposant à ses clients des services d’atténuation des incendies de forêt et des inondations. Il s’agit là d’un double avantage : des systèmes internes plus solides et une propriété intellectuelle monétisée.
Les dirigeants doivent aller au-delà des rapports ESG fragmentés et se concentrer sur les technologies de détection et l’infrastructure de données qui alimentent directement la prise de décision des dirigeants, et pas seulement les informations. C’est là que la vitesse, la précision et la valeur à long terme sont réellement générées.
La mise en place d’opérations robustes est de plus en plus importante par rapport aux modèles purement axés sur l’efficacité.
Le manuel opérationnel qui a dominé les dernières décennies était axé sur l’efficacité, la production en flux tendu, les chaînes d’approvisionnement étroitement intégrées, les stocks minimaux. Cette logique fonctionnait dans des environnements stables. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La volatilité du climat, les risques géopolitiques et les interruptions d’approvisionnement ont rendu ce niveau d’optimisation insoutenable.
Les entreprises qui recherchent une efficacité maximale se retrouvent aujourd’hui plus exposées et moins préparées. L’enquête 2024 de Bain montre que de nombreuses organisations continuent à donner la priorité à des tactiques d’amélioration de l’efficacité telles que l’automatisation et les outils de productivité, alors même que des mesures de résilience plus efficaces, telles que la diversification de l’offre, la décentralisation des opérations et la flexibilité de l’empreinte, sont sous-utilisées.
La robustesse ne consiste pas à augmenter les coûts. Il s’agit d’apporter des modifications à la conception qui permettent à un système de fonctionner sous pression sans défaillance. Il peut s’agir d’une redondance dans l’approvisionnement, de tampons supplémentaires dans la logistique ou d’un aménagement modulaire des installations qui peut être adapté rapidement en cas de pression. L’objectif n’est pas de renoncer à l’efficacité, mais de faire les deux, d’optimiser les performances sous contrainte.
Un grand fabricant applique déjà ce principe. Au lieu de réduire tous les stocks, il a mis en place une redondance intentionnelle dans les composants tels que les semi-conducteurs. Il a recours à un double approvisionnement dans différentes zones géographiques et conserve des stocks de sécurité dans des catégories de produits clés. Il ne s’agit pas de centres de coûts à court terme, mais de décisions concernant le temps de fonctionnement à long terme.
L’évolution de la gouvernance est essentielle pour intégrer la résilience climatique au niveau du conseil d’administration et de l’organisation.
Pour de nombreuses entreprises, la résilience reste cantonnée à un niveau intermédiaire. Aucune fonction exécutive n’en est véritablement responsable. Les équipes chargées du développement durable génèrent des informations, les équipes chargées des risques signalent les expositions, mais les processus d’allocation des capitaux et de gouvernance contournent souvent ces signaux. Il en résulte une inertie, des discussions sans appropriation et des risques sans action.
Cette situation doit changer. Certaines entreprises ont déjà réagi. Elles créent des postes de responsables de la résilience ou des conseils de la résilience climatique qui s’étendent à toutes les fonctions de l’entreprise. Ces structures sont habilitées à diriger les investissements, à modifier les seuils opérationnels et à influencer la planification au niveau du conseil d’administration. Mais la structure n’est qu’un élément.
La résilience doit faire partie du flux de données de l’entreprise. Les dirigeants doivent suivre les paramètres d’adaptation avec la même rigueur que celle qu’ils appliquent aux marges ou à la précision des prévisions. Cela implique de véritables tableaux de bord, et non des rapports statiques, ainsi qu’un retour d’information qui permette de sélectionner les fournisseurs, de planifier les investissements et d’agrandir les installations.
Un fabricant de biens de consommation a intégré des indicateurs physiques de risque climatique directement dans ses tableaux de bord. Il s’agit notamment des niveaux d’exposition des fournisseurs, des scores de vulnérabilité climatique et de l’état des approvisionnements d’urgence. Ces mesures influencent les décisions réelles, et pas seulement la conformité.
Une adaptation bien menée peut transformer les défis climatiques en un avantage concurrentiel pour les entreprises
L’objectif n’est pas de réagir à chaque perturbation. L’objectif est de s’adapter à la volatilité. Les entreprises qui intègrent l’adaptation au climat dans leur stratégie ne se contentent pas de protéger leurs actifs, elles se positionnent pour gagner. Lorsque les marchés changent, que les infrastructures tombent en panne, que les chaînes d’approvisionnement sont instables, ces entreprises agissent plus rapidement, restent opérationnelles plus longtemps et servent des clients que d’autres ne peuvent pas servir.
Ce n’est pas de la théorie. Les entreprises qui investissent aujourd’hui dans des opérations résilientes trouvent de nouveaux modèles de revenus grâce à des services adaptés au climat, à une exécution plus fiable de la chaîne d’approvisionnement et à une reprise plus rapide en cas de perturbation. La visibilité sur les risques crée des options. Cette dernière permet d’agir en toute confiance alors que d’autres évaluent encore la situation.
Une adaptation efficace repose sur un leadership clair, une technologie intégrée et une discipline d’investissement. Elle donne la priorité à la robustesse des systèmes les plus importants, plutôt que d’essayer de contrôler toutes les variables. C’est là que le leadership fait la différence : il s’agit d’être décisif sur ce qu’il faut protéger, sur ce qu’il faut assouplir et sur le moment où il faut agir.
Plus important encore, il ne s’agit pas seulement d’une question de responsabilité d’entreprise ou d’image de marque de durabilité. Il s’agit de se positionner de manière compétitive sur un marché mondial instable. Les entreprises qui fonctionnent bien dans des conditions de stress gagnent plus rapidement la confiance de leurs réseaux d’approvisionnement, de leurs clients et des investisseurs.
Dernières réflexions
Il ne s’agit pas de théorie climatique. Il s’agit d’une question d’exécution commerciale. Les perturbations sont réelles et touchent déjà les marges, les chaînes d’approvisionnement, la capacité de travail et les portefeuilles de risques. Ce qui sépare les entreprises qui survivent de celles qui prennent les devants, c’est la rapidité de réaction, la clarté de la structure et la qualité des données.
Si vous traitez encore le risque climatique comme une question de durabilité à long terme, vous êtes déjà à la traîne. La résilience doit être opérationnelle. Elle doit façonner l’allocation des capitaux, les décisions d’approvisionnement et la gestion des risques de l’entreprise. Elle doit évoluer au rythme de tout ce que vous suivez dans vos examens trimestriels.
Les entreprises qui prospèrent sous la pression ne se contentent pas de s’adapter, elles gagnent du terrain. Elles convertissent la visibilité des risques en mouvements concurrentiels et construisent des systèmes qui fonctionnent dans l’incertitude. Il ne s’agit pas d’une simple protection. C’est un effet de levier.
Le leadership consiste désormais à s’organiser pour faire face aux perturbations, et non plus à attendre la stabilité. Faites de la résilience une compétence de base avant que le marché ne l’exige de vous.