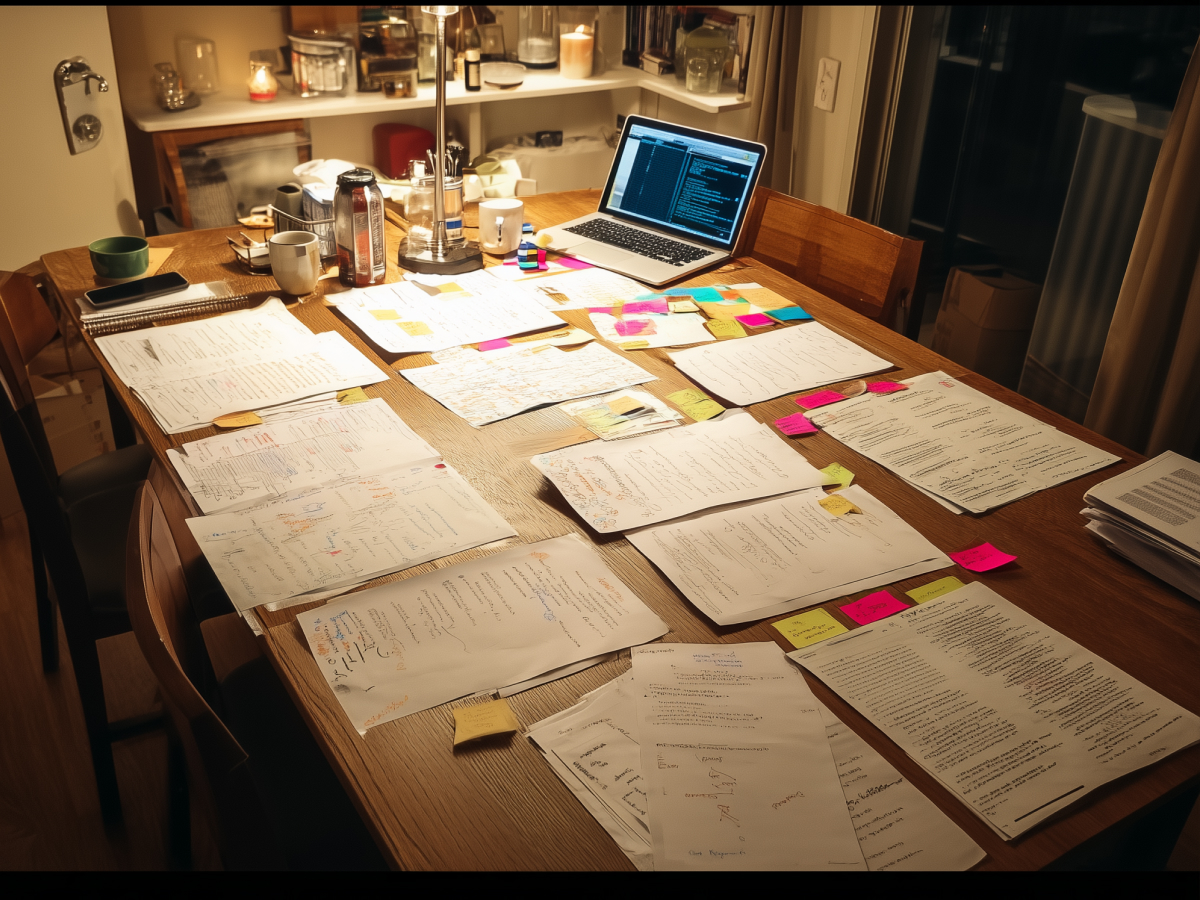Les défis de l’observabilité dans les systèmes distribués modernes
L’infrastructure moderne n’est pas simple. Les environnements numériques actuels sont plus dynamiques, décentralisés et interdépendants que jamais. Les services communiquent avec d’autres services. Les éléments de configuration changent rapidement. Les données circulent sans arrêt. Les ingénieurs doivent gérer tout cela tout en assurant une haute disponibilité et des réparations rapides en cas de panne. C’est là qu’interviennent les plateformes d’observabilité, qui offrent une visibilité sur les journaux, les mesures et les traces qui permettent d’identifier les problèmes plus rapidement.
Mais les outils habituels ne sont pas à la hauteur de l’échelle et de la complexité auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Pensez à ce qui s’est passé en juillet 2024 : CrowdStrike a publié une mise à jour de la configuration de son capteur Falcon qui a provoqué le plantage de machines Windows dans le monde entier. Des millions d’appareils dans les secteurs de la banque, des transports, de la vente au détail, etc. Il a fallu des heures pour identifier la cause première et contenir les retombées. Autre exemple : en 2016, un petit paquet JavaScript appelé left-pad a été supprimé de npm. Cela semble banal, n’est-ce pas ? L’effet d’entraînement a été tout autre. Des milliers d’applications et de sites web sont tombés en panne. Ce type de défaillances en cascade, à l’échelle du système, nous rappelle à l’ordre : nous exploitons des systèmes dans lesquels de petits changements peuvent entraîner une instabilité massive.
Pour éviter ces situations, nous avons besoin de plus qu’un simple aperçu de ce qui se passe. La télémétrie peut vous montrer que quelque chose ne va pas, mais souvent elle ne vous dit pas exactement pourquoi, ou quel changement en amont en est la cause. Lorsque les causes profondes se cachent derrière une communication asynchrone et des dépendances profondément imbriquées, les signaux de surface tels que les journaux et les traces ne font généralement qu’effleurer la surface. Ce n’est pas suffisant.
Les dirigeants devraient considérer cela non pas comme une limitation technologique, mais comme une inévitabilité de la mise à l’échelle de systèmes logiciels complexes. Votre infrastructure n’est pas cassée, elle a simplement évolué. Et les outils qui vous ont aidé hier ne résoudront pas les problèmes de demain. Résoudre le problème de l’observabilité aujourd’hui signifie accepter que la complexité est permanente et choisir des moyens plus intelligents pour la comprendre.
Capacités et limites des LLM et de l’IA agentique
Les LLM, grands modèles de langage, sont impressionnants. Ils résument les journaux, expliquent les messages d’erreur, génèrent des scripts et recommandent même des correctifs. Ajouter
l’IA agentique
et vous avez maintenant des systèmes qui planifient et agissent, redémarrant les services, rétablissant les configurations, validant les états et répondant aux anomalies. Tout ce concept évolue rapidement. Mais il y a des limites claires dont vous devez être conscient.
Voyons ce qu’il en est. Les LLM sont formés sur d’énormes ensembles de données. Ils sont très doués pour la reconnaissance de modèles dans le langage, le code, les journaux, les commentaires. Posez-leur des questions techniques et ils vous donneront généralement des réponses exploitables. Utilisez-les pour trier les journaux d’incidents et ils feront gagner un temps considérable à vos ingénieurs. Ils peuvent même écrire des fichiers de configuration à partir de zéro. Mais ce n’est que la surface.
Les LLM ne comprennent pas vraiment les systèmes. Ils ne connaissent pas l’architecture de votre pile. Ils ne savent pas comment les services se connectent ou ce qui se passe lorsqu’une ressource partagée atteint son maximum. Ils ne se souviennent pas de ce qui a échoué le mois dernier, ni pourquoi. Ils se contentent de traiter les données d’entrée et de prédire la meilleure sortie suivante. Alors oui, ils suggèrent des solutions plausibles. Mais parfois, ils se trompent. Vous obtenez des hallucinations, des explications confiantes et soignées qui ne sont tout simplement pas vraies.
L’IA agentique améliore cette situation. Pensez-y comme si vous mettiez le modèle dans le siège du conducteur. Il peut raisonner, planifier des actions, appeler des outils et apprendre à partir des résultats. Le cadre ReAct, présenté par Yao et al. en 2022, utilise une boucle de rétroaction étroite : l’IA pense, agit, vérifie le résultat et continue d’avancer. Cela confère une réelle puissance à l’observabilité. Les machines peuvent prendre des décisions, et pas seulement des commentaires.
Mais même avec toute cette puissance, l’IA agentique ne « connaît » pas intrinsèquement votre environnement. Elle ne dispose pas de cartes structurelles sur la manière dont les services interagissent en coulisses. Aucun sens de l’impact causal lorsque les choses tournent mal. Vous obtenez donc des solutions rapides aux symptômes, en redémarrant quelque chose, en tuant un pod, en annulant un changement. Et, pendant un certain temps, les problèmes se calment. Mais si la cause première est plus profonde, ils reviennent. C’est un problème.
Pour les dirigeants, cette nuance est importante. Investir dans l’IA ne signifie pas acheter de la magie. Vous devez associer ces outils à des modèles qui comprennent vos systèmes dans leur contexte. Sinon, vous êtes toujours en train de lutter contre les incendies, mais plus rapidement. Si vous souhaitez obtenir des gains significatifs en termes de disponibilité et de fiabilité, les outils d’IA doivent être connectés à l’architecture qu’ils sont censés gérer. Sans contexte, l’intelligence s’effondre.
Le rôle critique du raisonnement causal dans le diagnostic des incidents
La manière dont la plupart des systèmes abordent la détection des causes profondes présente un défaut fondamental : ils se concentrent trop sur ce qui s’est passé et pas assez sur les raisons de ce qui s’est passé. Les journaux, les traces et les mesures vous indiquent que quelque chose ne va pas. Ils ne vous indiquent pas la cascade qui en est à l’origine. C’est là que le raisonnement causal change tout.
Le raisonnement causal fait une chose exceptionnellement bien : il relie la cause à l’effet. Il ne se base pas simplement sur la corrélation, mais sur une logique structurée ancrée dans le comportement réel des systèmes. Cela se fait au moyen de graphes de causalité. Il ne s’agit pas de cartes de dépendances traditionnelles ; elles codent la façon dont des conditions spécifiques se propagent dans les services et l’infrastructure. Lorsqu’une panne survient, vous pouvez analyser non seulement la télémétrie au niveau de la surface, mais aussi la retracer à travers des chemins définis de causalité potentielle.
Judea Pearl a présenté ces graphes de causalité comme une approche formelle pour raisonner sur les causes et les effets, et leur utilisation dans l’ingénierie de la fiabilité est en train de gagner du terrain. Ces graphes modélisent la façon dont des types spécifiques de fautes, la saturation des connexions, les déversements de mémoire, la contention des verrous, s’expriment à l’échelle du système. Ils aident à détecter quels problèmes créent quels symptômes et comment ces symptômes apparaissent en fonction de l’endroit où la panne se produit dans votre architecture.
Lorsque vos systèmes deviennent trop complexes pour qu’une seule personne, ou même une équipe, puisse en assurer le suivi, le raisonnement causal fournit la logique structurelle nécessaire pour maintenir le contrôle. Il permet d’éviter le bruit et de concentrer l’attention sur ce qui compte : la condition d’origine qui a déclenché une cascade.
Pour les chefs d’entreprise, c’est important car un outillage réactif entraîne des pertes de temps. Les pertes de temps entraînent des interruptions de service. Le raisonnement causal permet aux équipes de passer de la résolution des symptômes à la résolution du système. Cela réduit l’impact des incidents, l’épuisement des ingénieurs et les frais généraux opérationnels, non pas en ajoutant plus de données, mais en les interprétant intelligemment.
Le raisonnement causal abductif et ses avantages
Même lorsque vous avez cartographié les relations de cause à effet dans vos systèmes, la recherche de la cause première n’est pas automatique. Vous avez besoin d’une méthode capable de prendre en compte des observations incomplètes et bruyantes et de formuler une hypothèse solide et rationnelle sur ce qui ne va pas. Il s’agit du raisonnement abductif, un processus qui propose l’explication la plus probable à partir des données disponibles.
Voici comment cela fonctionne : Supposons que vos services lancent des dépassements de délai et que vous constatez une latence dans les composants en amont. Un LLM basique commencera à redémarrer les services en se basant sur les logs. Cela peut fonctionner pendant un moment, mais le problème revient ensuite, car la source n’est pas dans les services. Elle est enfouie plus haut : une limite de ressources atteinte, par exemple, n’émet pas de signal direct. Le raisonnement abductif examine les symptômes, comprend quelles causes produisent généralement ces résultats et calcule ce qui correspond le mieux, même en tenant compte des données non observées ou manquantes.
Dans la pratique, il s’agit d’associer les graphes de causalité à l’inférence bayésienne. Vous établissez des probabilités préalables (probabilité d’apparition d’un symptôme sous certaines conditions), puis vous utilisez les symptômes en temps réel pour mettre à jour l’estimation. Il s’agit désormais de votre meilleure explication, et non plus d’une simple supposition. Et il ne s’agit pas d’une hypothèse. Dans le scénario précédent d’épuisement des ressources R2, le raisonnement abductif a permis de localiser le chemin de défaillance correct, même s’il n’y avait pas d’alerte télémétrique directe à ce sujet. C’est de l’automatisation intelligente.
Pour les entreprises, c’est là que se trouve le véritable avantage. Le raisonnement causal fournit une structure. L’inférence abductive donne une direction. Et surtout, il empêche les fausses résolutions, ces solutions à court terme qui semblent correctes mais qui ne mènent nulle part. C’est essentiel lorsque votre infrastructure prend en charge des services exigeant une disponibilité mondiale.
L’investissement est ici stratégique, et pas seulement opérationnel. Il ne s’agit pas de surveiller davantage, mais de décider mieux. Lorsque vos systèmes dépassent l’échelle de la reconnaissance humaine des modèles, vous avez besoin d’une intelligence méthodique qui relie les traces de preuves pour aboutir à la bonne décision. C’est ce que permet le raisonnement causal abductif.
Limites et défis du raisonnement causal
Le raisonnement causal fonctionne lorsque vous disposez des bons modèles. C’est la mise en garde qui s’impose. Vous avez besoin de représentations précises et actualisées de la manière dont vos services et votre infrastructure sont liés les uns aux autres. Ces modèles ne se construisent pas tout seuls. Quelqu’un doit les définir, les affiner et les maintenir alignés sur les changements dans les modèles de trafic, les architectures ou la conception des systèmes.
Cela implique des efforts. Cela signifie du temps. Pas dans la mise en œuvre initiale, qui est gérable, mais dans la maintenance. Les systèmes évoluent. Les microservices sont divisés, les services sont dépréciés, les ressources du cloud sont réaffectées. Si les graphiques de causalité qui sous-tendent votre intelligence diagnostique n’évoluent pas avec eux, leur utilité s’estompe rapidement. La qualité des recommandations diminue parce que la logique sur laquelle elles reposent ne reflète plus la réalité.
Il y a également un compromis sur le plan informatique. Dans les systèmes à grande échelle, il n’est pas trivial de raisonner sur des candidats concurrents à la cause première et d’exécuter une inférence probabiliste sur un graphe tentaculaire. Si vous avez dix symptômes possibles et cinq candidats défaillants concurrents, le calcul du scénario le plus approprié prend du temps et de l’argent, en particulier dans des conditions de temps réel. C’est une bonne chose si l’espace du problème est étroit et bien défini, mais cela devient coûteux dans des systèmes plus vastes et moins contraints.
Pour les décideurs, la conclusion est simple. Les systèmes causaux excellent dans les scénarios de défaillance complexes, mais pour qu’ils fonctionnent, vous devez investir dans leur précision à long terme. Ils nécessitent une modélisation spécifique au domaine et une validation fréquente. Sans cela, le moteur n’a pas de base solide sur laquelle s’appuyer. Ce n’est pas un inconvénient, c’est la réalité. Plus vous voulez que votre réponse aux incidents soit intelligente, plus vous devez lui donner un contexte structurel.
Le retour sur investissement est là. Identification plus rapide des causes profondes. Moins de temps d’arrêt. Moins de triage manuel au sein des équipes d’ingénieurs. Mais seulement si vous traitez la couche de modélisation avec autant de sérieux que les outils qui l’utilisent.
Intégration du raisonnement causal avec les LLM et l’IA agentique pour la fiabilité autonome
C’est là que les choses deviennent intéressantes. Les LLM sont rapides avec le langage. Ils peuvent gérer les résumés, les diagnostics, la génération de code, tout ce qui est basé sur le texte. Mais ils ne raisonnent pas. Pas dans un sens structuré et causal. L’IA agentique peut agir, mais en l’absence de conseils fondés sur la structure du système, ces actions ne sont que des réponses superficielles et à court terme. Ce qui manque, c’est le contexte, et c’est ce que le raisonnement causal apporte.
L’intégration d’un moteur de raisonnement causal donne à ces systèmes la conscience qui leur manque. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des données. Il s’agit de leur donner un sens de manière intelligente. Un moteur de raisonnement causal fournit des modèles de défaillance connus, établit les relations entre les symptômes et les services et utilise le raisonnement probabiliste pour identifier les causes probables. C’est la couche qui permet à l’ensemble du système de fonctionner avec une prise de décision éclairée.
C’est dans ce modèle hybride, LLM plus raisonnement causal, que nous passons des flux de travail tactiques à l’ingénierie stratégique de la fiabilité. Les LLM offrent toujours une interaction flexible en langage naturel pour l’interrogation et le résumé. Ils ne disparaîtront pas. Mais lorsqu’ils sont associés à un moteur d’inférence causale, ils deviennent plus que des assistants, ils deviennent des moteurs de décision structurés et reproductibles. Ils peuvent prendre des symptômes, les faire correspondre à des défauts candidats classés par ordre de priorité, évaluer la probabilité et proposer des interventions réelles, basées sur le contexte.
La structure sous-jacente emprunte ici au raisonnement neuro-symbolique. Un modèle gère la génération de modèles, l’autre l’évaluation logique. Vous utilisez les deux. C’est ainsi que vous pouvez dépasser les systèmes réactifs qui chassent la télémétrie de surface et commencer à construire des environnements proactifs qui comprennent les modes de défaillance avant que les clients ne le fassent.
Pour les dirigeants qui s’intéressent aux stratégies de fiabilité modernes, il s’agit d’une valeur fondamentale : de meilleures décisions, moins d’interruptions de service et une plus grande prévisibilité dans la résolution des problèmes. Ces gains se traduisent directement par une réduction des coûts opérationnels, des temps de reprise plus rapides et une plus grande confiance de la part des utilisateurs. Mais le fossé va se creuser entre ceux qui se contentent de déployer des LLM et ceux qui les associent à une intelligence causale structurée. L’avenir de la fiabilité des services repose sur le second groupe.
Le potentiel de transformation des agents causaux
Les agents causaux représentent une nette progression par rapport aux chaînes d’outils réactives et au triage effectué par l’homme. Ces systèmes ne se contentent pas de surveiller les performances ou de résumer les erreurs, ils comprennent ce qui ne fonctionne pas, pourquoi cela ne fonctionne pas et comment y remédier de manière autonome. Lorsqu’ils sont correctement exécutés, ils ouvrent la voie à un nouveau modèle opérationnel dans lequel les plateformes façonnent activement leur propre stabilité et leur propre résilience, au lieu de se contenter de signaler les dégradations lorsqu’il est déjà trop tard.
Ce qui distingue les agents causaux, c’est qu’ils combinent trois capacités : la compréhension du langage, le raisonnement sur la structure du système et l’inférence causale. Ils ne s’appuient pas uniquement sur des mesures visibles ou des codes d’erreur. Ils exploitent les connaissances préalables sur les dépendances, les limites de performance et la manière dont les différents états du système interagissent. Ils prennent des symptômes partiels ou indirects et calculent l’explication la plus cohérente, la cause première, et pas seulement ce qui semble probable à première vue.
Ce processus leur permet de déclencher des mesures correctives ciblées en toute confiance. Au lieu de redémarrer des services au hasard ou de proposer de vagues modifications de configuration, les agents de causalité identifient la condition exacte ayant un impact sur la fiabilité et agissent ou recommandent en conséquence. Au fil du temps, à mesure qu’ils observent davantage de défaillances, leur compréhension s’approfondit et la précision de leurs diagnostics s’améliore. Il ne s’agit pas d’une théorie abstraite, mais d’un changement opérationnel fondé sur l’intelligence en couches.
Du point de vue de la direction, cela modifie la structure des coûts de la gestion des technologies de l’information. La capacité de l’équipe évolue généralement de manière linéaire en fonction de la taille du système, ce qui n’est pas le cas des défaillances. Elles évoluent de manière imprévisible. Les agents de causalité permettent de découpler la fiabilité de l’intervention humaine. Cela crée un effet de levier. L’effort d’ingénierie se déplace vers le haut de la chaîne de valeur, le coût des incidents tend à diminuer et les paramètres relatifs aux clients commencent à se stabiliser sur de plus longues périodes.
Alors que les outils d’observabilité actuels permettent aux équipes de se faire une idée, les agents causaux confèrent une autonomie aux systèmes. Cette distinction est importante. Elle reflète l’abandon de la chasse aux problèmes au profit de leur prévention, en minimisant l’impact avant qu’une escalade ne soit nécessaire. Tel est l’objectif : des systèmes très stables qui fonctionnent avec un minimum de temps d’arrêt, des diagnostics plus rapides et des mesures correctives précises, avec ou sans intervention humaine directe.
À long terme, c’est là que réside la transformation. Il ne s’agit pas seulement de comprendre la santé du système, mais de concevoir des systèmes qui la gèrent de manière proactive. Les agents causaux ne sont plus expérimentaux. Ils deviennent la norme pour les entreprises qui accordent la priorité au temps de fonctionnement, à l’échelle et à la vitesse opérationnelle dans l’infrastructure numérique. Plus l’investissement est précoce, plus les bénéfices sont importants. Les dirigeants qui alignent dès maintenant leurs ressources sur ces capacités seront les premiers à entrer dans une ère d’ingénierie des plateformes plus autonome et plus résiliente.
En conclusion
L’infrastructure moderne ne se simplifie pas. Elle évolue, elle est rapide, elle est interconnectée et elle est plus difficile à prévoir. Les outils d’observabilité traditionnels et les modèles d’IA basés sur la reconnaissance des formes ne vous permettront pas d’anticiper les défaillances. Ils s’attaquent aux symptômes et non aux causes. Tout va bien jusqu’à ce que quelque chose de critique se brise d’une manière que votre IA ne comprend pas, ou que votre équipe passe des heures à traquer le mauvais signal.
Le raisonnement causal permet d’aller de l’avant. Il donne à vos systèmes une structure, une logique et la capacité de raisonner, tout comme le font vos meilleurs ingénieurs, mais plus rapidement et constamment. Et lorsqu’il est associé aux LLM et à l’IA agentique, il pousse l’observabilité au-delà des idées et vers l’action. Le résultat est une fiabilité dynamique qui s’adapte à la croissance, au changement et au risque.
Pour les décideurs, il ne s’agit pas seulement d’une conversation technologique. Il s’agit d’une conversation commerciale. Moins de temps d’arrêt. Des fenêtres d’incident plus courtes. Satisfaction accrue des clients. Plus de temps consacré à l’innovation qu’à la lutte contre les incendies. Les organisations qui adoptent dès maintenant des systèmes de connaissance des causes prendront des décisions techniques plus pointues, avec moins de cycles manuels, des coûts opérationnels plus faibles et des résultats plus probants.
La fiabilité ne consiste plus à réagir rapidement, mais à savoir où chercher avant même qu’il y ait un problème. Ce changement ne se produit que lorsque l’intelligence est ancrée dans la structure. C’est le véritable déverrouillage.